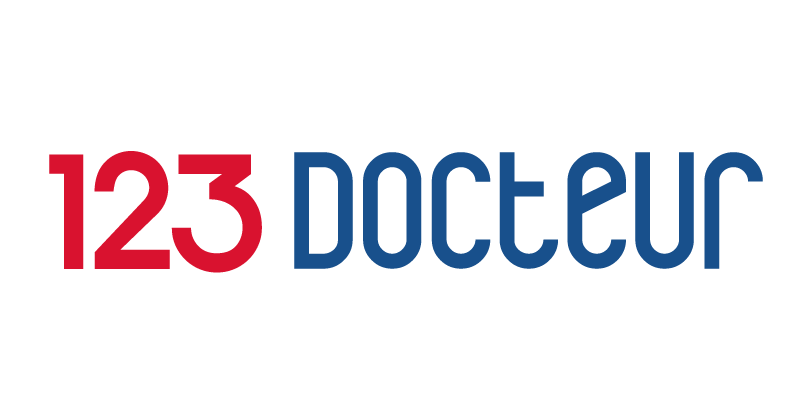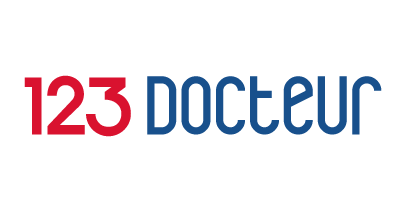Lorsqu’une grossesse est classée à haut risque, certaines interventions médicales peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la sécurité de la mère et du bébé. Le cerclage cervical est l’une de ces procédures, souvent recommandée pour prévenir les accouchements prématurés chez les femmes présentant une insuffisance cervico-isthmique. Elle consiste en la mise en place d’un fil autour du col de l’utérus pour le maintenir fermé jusqu’à terme.
Cette intervention n’est pas sans risques. Elle peut entraîner des complications telles que des infections, des saignements ou des contractions prématurées. Chaque cas doit donc être soigneusement évalué par des professionnels de santé pour déterminer la pertinence de cette procédure.
Qu’est-ce que le cerclage en cas de grossesse à haut risque ?
Le cerclage est une procédure médicale visant à resserrer le col de l’utérus à l’aide d’un fil ou d’une bandelette. Cette intervention est particulièrement indiquée pour les femmes présentant une béance cervicale ou une incompétence cervicale, conditions qui peuvent mener à des complications telles que des fausses couches tardives ou des accouchements prématurés. En resserrant le col, le cerclage aide à maintenir la grossesse jusqu’à terme.
Conditions nécessitant un cerclage
- Béance cervicale
- Incompétence cervicale
- Insuffisance cervicale
- Historique de fausses couches tardives ou d’accouchements prématurés
Les types de cerclage
Il existe plusieurs techniques de cerclage, chacune adaptée à des situations spécifiques :
- Cerclage à froid : Pratiqué entre 12 et 15 SA, il est aussi appelé cerclage prophylactique.
- Cerclage à chaud : Réalisé en urgence entre 16 et 24 SA, il est aussi connu sous le nom de cerclage thérapeutique.
Techniques spécifiques
Le cerclage peut être effectué par différentes méthodes :
- Technique de Mac Donald : Consiste à nouer un fil de nylon non résorbable autour du col de l’utérus.
- Technique Shirodkar : Implique d’inciser la muqueuse pour entourer le col d’une bandelette.
- Technique par voie abdominale : Nécessite d’ouvrir l’abdomen pour poser une bandelette autour du col.
Le cerclage peut être réalisé sous différentes formes d’anesthésie : générale, rachianesthésie, péridurale ou anesthésie combinée rachidienne-épidurale. Chaque méthode a ses indications spécifiques et doit être choisie en concertation avec une équipe médicale spécialisée.
Les étapes de la procédure de cerclage
Consultation pré-opératoire
Avant de procéder au cerclage, une évaluation exhaustive est réalisée. L’objectif : déterminer la nécessité et les conditions optimales pour l’intervention. Un examen clinique et des échographies sont réalisés pour évaluer la longueur et l’état du col de l’utérus.
Prise en charge anesthésique
Le cerclage peut être pratiqué sous différentes formes d’anesthésie : générale, rachianesthésie, anesthésie péridurale ou anesthésie combinée rachidienne-épidurale. Le choix de l’anesthésie dépend à la fois des préférences de la patiente et des recommandations de l’équipe médicale.
Technique chirurgicale
Trois méthodes principales sont utilisées pour le cerclage :
- Technique de Mac Donald : Cette méthode consiste à nouer un fil de nylon non résorbable autour du col de l’utérus. Elle est la plus couramment employée.
- Technique Shirodkar : Implique l’incision de la muqueuse pour entourer le col d’une bandelette. Cette technique est souvent réservée aux cas plus complexes.
- Technique par voie abdominale : Nécessite une ouverture de l’abdomen pour poser une bandelette autour du col. Utilisée en dernier recours.
Post-opératoire immédiat
Après l’intervention, une surveillance étroite est mise en place pour détecter toute complication éventuelle, notamment des contractions utérines ou des signes d’infection. La patiente reste généralement hospitalisée pour une période d’observation avant de pouvoir regagner son domicile.
Suivi et gestion de la grossesse
Le suivi post-cerclage inclut des consultations régulières et des échographies pour s’assurer de la bonne tenue du cerclage et de l’évolution de la grossesse. Le cerclage est retiré, ou décerclage, vers la 37e semaine d’aménorrhée, sauf indication contraire.
Le maintien d’un suivi rigoureux et de consultations régulières permet d’optimiser les chances de mener la grossesse à terme.
Les risques associés au cerclage
Infections post-opératoires
Le cerclage présente un risque accru d’infection, notamment au niveau du col de l’utérus. Une vigilance particulière est requise pour détecter tout signe d’infection, comme la fièvre ou les écoulements anormaux. Un traitement antibiotique prophylactique peut être envisagé en fonction de l’évaluation pré-opératoire.
Contractions utérines
Les contractions utérines constituent un autre risque notable post-cerclage. Ces contractions peuvent entraîner un travail prématuré, rendant fondamental le suivi médical régulier. Les patientes doivent signaler immédiatement toute contraction douloureuse ou persistante.
Déchirement et dystocie cervicale
Le risque de déchirement cervical est présent lors du retrait du fil ou de la bandelette. La dystocie cervicale, une difficulté à dilater le col lors de l’accouchement, peut aussi survenir. Ces complications nécessitent une gestion précise et une décision rapide pour éviter des conséquences graves pour la mère et l’enfant.
Accouchement prématuré et fausse couche tardive
Le cerclage vise à prévenir l’accouchement prématuré et les fausses couches tardives, mais il peut paradoxalement augmenter ces risques dans certains cas. Une surveillance échographique fréquente et une évaluation clinique permettent de détecter les signes avant-coureurs d’un éventuel accouchement prématuré.
- Évitez toute infection en suivant scrupuleusement les consignes médicales post-opératoires.
- Signalez immédiatement toute contraction utérine anormale.
- Suivez les rendez-vous de surveillance échographique pour détecter précocement les complications.
Suivi post-cerclage et gestion de la grossesse
Surveillance médicale rigoureuse
Après un cerclage, un suivi médical strict est essentiel. Des consultations régulières permettent de surveiller l’état du col de l’utérus et de détecter toute anomalie. Les échographies transvaginales sont souvent utilisées pour mesurer la longueur cervicale et évaluer la tension exercée par le cerclage.
Repos et limitations d’activités
Il est fréquemment recommandé aux patientes de limiter leurs activités physiques pour réduire les risques de complications. Le repos peut inclure :
- Éviter les efforts physiques intenses.
- Réduire les déplacements inutiles.
- Respecter le repos allongé si prescrit.
Décerclage
Le décerclage, ou retrait du cerclage, est généralement prévu autour de la 37e semaine d’aménorrhée. Cette intervention est réalisée pour éviter tout risque de déchirement du col lors de l’accouchement. Un monitoring fœtal est souvent effectué pour s’assurer du bien-être du bébé avant et après le décerclage.
Gestion des complications
En cas de contractions prématurées ou d’infections, une intervention médicale rapide est nécessaire. Les patientes doivent être informées des signes à surveiller et des mesures à prendre en cas de symptômes alarmants. Une hospitalisation peut être envisagée en cas de menace sérieuse pour la santé de la mère ou du fœtus.
Le suivi post-cerclage est une composante fondamentale pour assurer une grossesse à terme en toute sécurité. La collaboration étroite entre la patiente et son équipe médicale permet de minimiser les risques et de maximiser les chances de succès de cette procédure délicate.